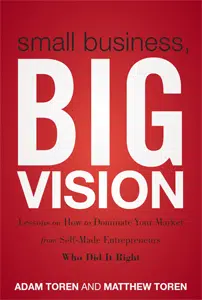Sanctionner une discrimination ne nécessite pas que la victime appartienne réellement à une catégorie protégée, mais seulement qu’elle soit perçue comme telle. La protection s’étend même à ceux qui témoignent ou refusent de participer à un acte discriminatoire. En France, vingt critères sont expressément mentionnés dans le Code du travail et le Code pénal, mais leur interprétation évolue régulièrement sous l’effet de la jurisprudence européenne. Un critère peut être retenu même s’il n’est pas explicitement cité par la loi, dès lors que l’intention discriminatoire est avérée.
Comprendre la discrimination au travail : enjeux et réalités
La discrimination au travail ne relève pas de la fiction. Elle s’invite chaque année dans la vie des entreprises françaises. Textes renforcés, actions du défenseur des droits : le bilan reste sans appel. Des plaintes affluent et toutes les strates de l’entreprise sont concernées, du recrutement à la rupture de contrat, en passant par la gestion des carrières.
Les règles sont nettes : aucune différence de traitement ne devrait reposer sur l’âge, le sexe, l’origine, l’état de santé, les opinions politiques ou d’autres critères similaires. Pourtant, la réalité dévie trop souvent. La frontière entre normes et pratiques s’estompe, exposant employeurs et managers à des sanctions civiles et pénales en l’absence de motif objectif.
Et sur le terrain, ces dérapages prennent des formes très concrètes. Parfois, la discrimination claque comme une porte refermée ; d’autres fois, elle s’insinue dans des process qui paraissent neutres. Le salarié pris au piège hésite à saisir les prud’hommes ou à alerter le défenseur des droits, par crainte de représailles ou manque d’informations fiables.
Pour rendre tangibles les deux grands types de discrimination, voici deux illustrations précises :
- Discrimination directe : refuser l’embauche d’un candidat sur la base de son origine.
- Discrimination indirecte : exiger une mobilité sans contraintes, excluant ainsi de fait des travailleurs en situation de handicap.
Actualisation des procédures RH, formation systématique des managers, engagement clair et suivi : voilà ce qui fait la différence. Les entreprises qui franchissent ce cap observent à la fois une baisse des tensions internes et une progression nette de la cohésion d’équipe.
Quels sont les 20 critères de discrimination à connaître absolument ?
La liste dressée par le code du travail ne laisse aucune place à l’ambiguïté : vingt critères de discrimination clairement posés, à maîtriser pour garantir la régularité de chaque choix RH, de l’embauche à l’avancement. Ces repères couvrent tout le champ du visible comme de l’invisible, de l’univers professionnel à l’espace intime.
Certains motifs sont familiers, d’autres touchent à la vie privée ou familiale. Parmi eux : le sexe, l’origine, la grossesse, la situation de famille, l’appartenance à une ethnie, une nation, ou une supposée race. Il faut également compter l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les mœurs, mais aussi l’âge, l’apparence physique, l’état de santé ou le handicap, et les caractéristiques génétiques.
Les convictions et situations extraprofessionnelles entrent aussi en considération lorsqu’elles ont des conséquences sur le travail : opinions politiques, activités syndicales, convictions religieuses, jusqu’à la domiciliation bancaire, le lieu de résidence ou l’aptitude à s’exprimer dans une autre langue. Pour clarifier la portée de ce cadre, voici chacun de ces critères :
- Sexe
- Origine
- Grossesse
- Situation de famille
- Appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race
- Mœurs
- Orientation sexuelle
- Identité de genre
- Âge
- Apparence physique
- Nom de famille
- Lieu de résidence
- État de santé, handicap
- Caractéristiques génétiques
- Convictions religieuses
- Opinions politiques
- Activités syndicales ou mutualistes
- Domiciliation bancaire
- Perte d’autonomie
- Capacité à s’exprimer dans une autre langue
Cette liste doit devenir un réflexe partagé au sein des directions RH et des managers. Sans cette vigilance, la conformité des pratiques reste fragile et chaque décision RH s’expose à un risque.
Pourquoi ces discriminations persistent-elles malgré la loi ?
La loi française multiplie les rappels à l’ordre, mais la discrimination au travail continue à s’infiltrer partout, du recrutement à l’évolution professionnelle. Les dispositifs existent, les peines sont prévues. Pourtant, l’expérience prouve que la réalité se dérobe derrière l’affichage réglementaire.
Des milliers de dossiers sont traités chaque année par le défenseur des droits. Les prud’hommes reçoivent des saisines couvrant toute la palette des discriminations, qu’il s’agisse d’absence d’avancement, de propos déplacés sur l’apparence physique ou l’état de santé. Pour la victime de discrimination, difficile d’apporter la preuve. Ce flou profite à l’inaction.
La culture d’entreprise joue un rôle décisif. Les biais se glissent dans tous les interstices : dans le tri des CV, dans les entretiens, dans la gestion de la mobilité. Des stéréotypes persistent sous couvert de neutralité. Si la formation sur ces sujets reste mise de côté, la situation ne change pas. Les effets se lisent dans la progression de l’absentéisme, du désengagement et l’affaiblissement de la marque employeur.
Pour agir, des solutions existent : faire vivre réellement le comité social, déployer des dispositifs disciplinaires, recourir si besoin à la cour de cassation ou au Conseil de prud’hommes. Mais la peur de riposte et la complexité des démarches freinent bien des alertes. Il devient urgent de sortir du pilotage automatique et d’inscrire cet enjeu au cœur des politiques RH.
Agir concrètement : conseils, ressources et leviers pour lutter efficacement
Les chartes affichées ne suffisent pas à faire reculer la discrimination. C’est la traduction en actes du quotidien qui fait reculer les mauvaises pratiques. La formation de tous, du manager à l’équipe RH, doit s’appuyer sur des cas vécus, ancrer les bons réflexes et outiller dès le recrutement.
Une vigilance accrue s’impose lors de la rédaction des offres d’emploi : chaque mot compte, chaque tournure peut véhiculer un biais ou exclure à tort. Les outils numériques comme les ATS apportent un regard neuf pour repérer ce qui échappe au screening humain lors du recrutement inclusif. Pendant les entretiens, s’appuyer sur des compétences claires et balisées, limiter l’interprétation subjective et objectiver les soft skills éloigne les risques de traitement inégal.
Certains points d’appui aident vraiment à avancer :
- Le recours à des guides pratiques publiés régulièrement pour décrypter ses obligations et adopter les bons réflexes.
- Le soutien du Défenseur des droits aide les salariés à chaque étape, de l’écoute à la médiation.
- Un audit RH confié à un tiers indépendant permet de dresser le bilan des pratiques et de mettre la lumière sur les angles morts.
Les labels comme le label diversité ou le label égalité professionnelle donnent un cap, rendent crédibles les démarches et structurent les engagements. Autre levier : le référent harcèlement du CSE, véritable vigie pour prévenir et résoudre les situations à risque. Changer durablement la donne passe par des actes répétés, cohérents, par une transformation qui s’incarne dans des décisions concrètes.
Quand la législation n’a plus le dernier mot, c’est la vigilance collective qui décide du climat de travail. La marge entre l’écrit et l’action se joue ici, dans le regard porté sur chaque situation, dans la volonté de bâtir un quotidien sans discrimination.